 Le Chi Kong ?
Le Chi Kong ?
par Alain Gesbert
Ci-après vous trouverez des explications synthétiques vous permettant de comprendre, intellectuellement, ce que l’on entend par Chi Chong, Chi Kong ou Qi Gong.
Pour comprendre la voie de l'énergie, il faut d'abord découvrir ce qui se cache derrière des mots, comme :
![]() Chi,
Chi,
![]() et
Zhan
Zhuang.
et
Zhan
Zhuang.
Le
Chi a la même signification que le
Prana
des Yogis. Pour les sages des temps anciens, il existe une énergie de vie qui
est associée à l’air que nous respirons. Elle est présente partout dans la
nature, même si on ne peut la voir. En pratiquant le Chi Chong, on fait
circuler cette énergie vitale. Il n’y a pas besoin de croire au Chi pour en
ressentir les bienfaits. Une pratique régulière, constante et assidue permet
d’en ressentir les effets.
L’idéogramme
Chong
exprime,
à la fois, l’énergie
et le temps.
Par Chong,
on entend, de façon plus générale, toute
activité basée sur l’énergie et avec le but de s’améliorer (en utilisant
la durée, le temps). Cela implique un minimum de persévérance, de discipline
et de régularité dans les exercices. Ces exercices corporels ne sont pas
qu’une simple gymnastique. Il faut, en effet, cultiver, progressivement, une
qualité de présence à ce que l’on fait (le fameux « ici et maintenant »).
Outre l’observation des mouvements physiques (et leurs bonnes exécutions), le
pratiquant développe une sensibilité à la circulation de l’énergie interne
(au niveau du Hara (Dantian), mais aussi, par exemple, du Laogong (au centre de
la main). Le temps (et l’entraînement) permet de développer une attitude de
réceptivité.
![]() Le
Chi Chong est un entraînement particulier permettant de faire circuler le Chi
dans son corps physique et les méridiens chinois. Il permet le « travail
de l’énergie ».
Le
Chi Chong est un entraînement particulier permettant de faire circuler le Chi
dans son corps physique et les méridiens chinois. Il permet le « travail
de l’énergie ».
![]() L’objectif
premier du Chi Chong
est l’harmonisation du corps et du mental à l’aide de
l’énergie. Il permet de restaurer ou de rééquilibrer l’énergie vitale en
pratiquant des exercices corporels (harmonisation du corps) associés à la
respiration et, suivant le cas, à la visualisation. Il permet, entre autre, de
développer le hara qui permet de se centrer, de calmer le mental et de mieux gérer
les agressions extérieures et le stress.
L’objectif
premier du Chi Chong
est l’harmonisation du corps et du mental à l’aide de
l’énergie. Il permet de restaurer ou de rééquilibrer l’énergie vitale en
pratiquant des exercices corporels (harmonisation du corps) associés à la
respiration et, suivant le cas, à la visualisation. Il permet, entre autre, de
développer le hara qui permet de se centrer, de calmer le mental et de mieux gérer
les agressions extérieures et le stress.
![]() Indépendamment
des différents enchaînements, il faut retenir qu’il existe deux grandes
familles d’exercices : les exercices statiques (comme l’arbre) et des
exercices en mouvement (dynamiques, au niveau de la forme extérieure), mais
avec des déplacements différents du Tai Chi (notamment au niveau du
positionnement des pieds par rapport au sol).
Indépendamment
des différents enchaînements, il faut retenir qu’il existe deux grandes
familles d’exercices : les exercices statiques (comme l’arbre) et des
exercices en mouvement (dynamiques, au niveau de la forme extérieure), mais
avec des déplacements différents du Tai Chi (notamment au niveau du
positionnement des pieds par rapport au sol).
Le
zhan zhuang fait partie des exercices dit statiques. Zhan peut se traduire par
« se tenir debout » et zhuang exprime un « pilier »
avec l’idée d’une « fondation ». Le zhan zhuang est, donc, une
position statique au niveau corporel : le pratiquant « se tient
debout comme un pilier » (pendant dix, puis progressivement, vingt, trente
minutes et plus). Cette pratique comprend une ou plusieurs postures en position
debout comme un arbre.
Beaucoup
d’occidentaux, ont associé, par ignorance, le zhan zhuang (la position de
l’arbre) au Chi Chong. Cette pratique en fait partie au titre des exercices
statiques. Le Chi Chong n’est pas que statique. Pour s’en convaincre, on
pourra étudier le Chi Chong de l’oie sauvage
qui est très sophistiqué et comprend de nombreuses « figures » en
mouvement.
![]() Le choix d’un professeur
?
Le choix d’un professeur
?
![]() Les
livres permettent de comprendre, intellectuellement, le Chi Chong (ses
bienfaits, sa philosophie, etc.). Par contre, il est très difficile
d’apprendre tout seul le Chi Chong, même si les photos, la qualité du texte,
etc., peuvent vous faire croire du contraire. En effet, la position de base
implique de savoir, entre autre, basculer correctement son bassin. Le cerveau a,
au début, une représentation erronée (suite aux mauvaises habitudes, etc.) de
la position verticale quand on fléchit, par exemple, les jambes. Le mental peut
d’ailleurs être, au début, agacé, etc., de ne pas arriver à faire des
exercices, en apparence, aussi simples. Comme toute résistance inconsciente,
cela peut également entraîner un verbiage pour se justifier, pour contester,
pour ne pas continuer, etc.
Les
livres permettent de comprendre, intellectuellement, le Chi Chong (ses
bienfaits, sa philosophie, etc.). Par contre, il est très difficile
d’apprendre tout seul le Chi Chong, même si les photos, la qualité du texte,
etc., peuvent vous faire croire du contraire. En effet, la position de base
implique de savoir, entre autre, basculer correctement son bassin. Le cerveau a,
au début, une représentation erronée (suite aux mauvaises habitudes, etc.) de
la position verticale quand on fléchit, par exemple, les jambes. Le mental peut
d’ailleurs être, au début, agacé, etc., de ne pas arriver à faire des
exercices, en apparence, aussi simples. Comme toute résistance inconsciente,
cela peut également entraîner un verbiage pour se justifier, pour contester,
pour ne pas continuer, etc.
![]() Un
bon professeur (outre ses compétences, son expérience, sa pédagogie, le temps
qu’il donne, etc.) pourra corriger les erreurs du débutant, il saura stimuler
ses élèves afin de vous permettre d’aller au-delà de vos résistances
inconscientes.
Un
bon professeur (outre ses compétences, son expérience, sa pédagogie, le temps
qu’il donne, etc.) pourra corriger les erreurs du débutant, il saura stimuler
ses élèves afin de vous permettre d’aller au-delà de vos résistances
inconscientes.
![]() Il
n’est pas toujours facile de trouver un bon enseignant, mais, lorsque vous êtes
prêt les circonstances, les évènements, les gens que vous rencontrez, vous
permettront de trouver celui qui vous correspond. Outre les qualités du
professeur (son expérience, etc.), il vous faut garder à l’esprit des
notions simples pour confirmer votre choix. En effet, il existe de nombreuses écoles.
Il
n’est pas toujours facile de trouver un bon enseignant, mais, lorsque vous êtes
prêt les circonstances, les évènements, les gens que vous rencontrez, vous
permettront de trouver celui qui vous correspond. Outre les qualités du
professeur (son expérience, etc.), il vous faut garder à l’esprit des
notions simples pour confirmer votre choix. En effet, il existe de nombreuses écoles.
Le critère le plus important est que
les mouvements doivent
respecter
l’anatomie du corps humain. Il faut que vous vous sentiez mieux après la
séance que lorsque vous êtes arrivé, même si vous débutez. Le cours doit être
accessible et progressif. Préférez des enchaînements simples à des exercices
trop sophistiqués (sauf si vous avez déjà une bonne expérience des arts
martiaux, par exemple). L’optimum est d’intégrer un petit groupe. Écoutez,
prenez le temps d’expérimenter, puis posez vos questions, ce que vous
ressentez, ce qui vous paraît difficile.
![]() Entre
les séances, il vous est demandé de pratiquer, afin que votre corps
s’habitue progressivement et que vous puissiez mémoriser l’enchaînement à
votre rythme. C’est lors de la correction des mouvements que vous pourrez apprécier
l’expérience et le savoir-faire de l’enseignant.
Entre
les séances, il vous est demandé de pratiquer, afin que votre corps
s’habitue progressivement et que vous puissiez mémoriser l’enchaînement à
votre rythme. C’est lors de la correction des mouvements que vous pourrez apprécier
l’expérience et le savoir-faire de l’enseignant.
![]() S’il
va trop vite, sans corriger, etc., c’est que, probablement, vous n’avez pas
encore trouvé un très bon professeur. Ce que vous avez appris est, déjà, un
début. Persévérez et il n’y a aucune raison pour que vous ne le trouviez
pas…
S’il
va trop vite, sans corriger, etc., c’est que, probablement, vous n’avez pas
encore trouvé un très bon professeur. Ce que vous avez appris est, déjà, un
début. Persévérez et il n’y a aucune raison pour que vous ne le trouviez
pas…
![]() Alain
Gesbert
Alain
Gesbert
![]() Page d'accueil
de toutes nos activités
Page d'accueil
de toutes nos activités
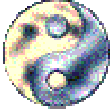
Photo : Alain Gesbert
![]()